Accès aux images satellites haute résolution du dispositif DINAMIS
 La MSHE Ledoux, avec sa plateforme technologique SHERPA, propose aux laboratoires fédérés un accès simplifié à des images de haute et très haute résolution spatiale via le dispositif DINAMIS (1).
La MSHE Ledoux, avec sa plateforme technologique SHERPA, propose aux laboratoires fédérés un accès simplifié à des images de haute et très haute résolution spatiale via le dispositif DINAMIS (1). Ce dernier prend la suite de dispositifs existants, tel GEOSUD, et offre un accès unifié à différents jeux d’imageries satellitaires : imageries commerciales optiques (Pléiades, Spot 6-7) et un bouquet d’images gratuites (Sentinel 2, archives Spot 1-5 du programme Spot World Heritage, archives du projet Kalidéos…).
DINAMIS propose en outre un service de programmation des satellites Pléiades ou Spot 6-7 et une application web permettant de transmettre les besoins d’imageries.
La navigation dans le catalogue DINAMIS et la visualisation des données sur le site sont en accès libre. Leur téléchargement et les demandes d’acquisition nécessitent en revanche la création de comptes (par la structure et le chercheur).
Parution: La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots-clés
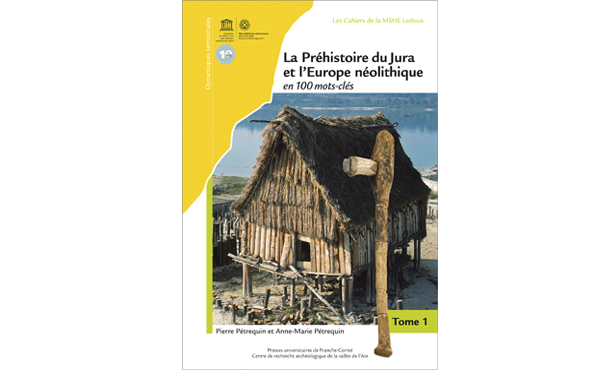 La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots-clés
La Préhistoire du Jura et l'Europe néolithique en 100 mots-clés Pierre Pétrequin et Anne-Marie Pétrequin
Formés à l’ethnoarchéologie en Nouvelle-Guinée, les auteurs proposent une lecture originale de la trajectoire historique des premières communautés d’agriculteurs entre 5300 et 2400 av. J.-C., où les microrégions – ici le Jura et les plaines de Saône – étaient profondément intégrées à des réseaux complexes de circulation d’objets-signes et d’idées. À l’échelle de l’Europe occidentale, ces transferts à longue distance étaient soutenus par la compétition sociale, l’affichage des inégalités et l’imaginaire religieux. 100 mots-clés du vocabulaire archéologique permettent d’explorer différentes interprétations sociales cachées derrière les objets et les comportements des populations néolithiques.
Plus d’information
Commander
Version numérique sur OpenEdition books
Parution: Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960)
 Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960) - Histoire d'une tension légale
Propriété, cadastre et usages locaux dans les campagnes françaises (1789-1960) - Histoire d'une tension légale Fabien Gaveau
Préface de Nadine Vivier
Les Cahiers de la MSHE
La Révolution entreprend de rationaliser le droit de propriété en l’inscrivant dans la possession du sol. Pourtant, la situation du pays oblige à tolérer des usages qui fondent le rapport aux terres. La définition d’une nouvelle fiscalité, avec pour référence le cadastre fiscal, pousse à valoriser le propriétaire du sol, que le suffrage censitaire avantage jusqu’en 1848. Or, de la Corse au Nord, de la Bretagne à l’Alsace, des Pyrénées aux Ardennes, les cadres de vie présentent des spécificités difficiles à plier aux désirs des promoteurs d’un droit foncier privatif. Jusque dans les années 1960, cette relation conflictuelle est la matrice de la définition de l’exploitation agricole.
Plus d’information
Commander

Débat suite à La pensée de la race en Italie (collection des Cahiers de la MSHE)
Lire « Nucleo logico fondamentale » e differenze. Un dibattitto sull’idea di razza
Plus d'information sur La pensée de la race en Italie
Nouvelles actions de recherche
 La programmation scientifique de la MSHE Ledoux s’enrichit de quatre nouvelles actions, dans le pôle 2 « Interactions homme - environnement », le pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs », le pôle 4 « Archive, bases, corpus » et le pôle 5 « Comportements, risques, santé ».
La programmation scientifique de la MSHE Ledoux s’enrichit de quatre nouvelles actions, dans le pôle 2 « Interactions homme - environnement », le pôle 3 « Normes, pratiques et savoirs », le pôle 4 « Archive, bases, corpus » et le pôle 5 « Comportements, risques, santé ».Présentation des actions.
RIFTS - Habiter des environnements aux RIsques de Fissures Territoriales et Sociales
Responsable : Sophie Némoz, LASA (EA 3189)
Si les fissures ne sont pas rares dans les constructions des cadres de vie et des paysages, l’action RIFTS tente de comprendre comment elles réinterrogent les manières d’habiter dans des rapports dynamiques et fragmentés aux mondes que l’environnement incarne. Visant à s’approprier collectivement les termes et les enjeux, c’est une liminarité qui guide le dialogue entre les sciences humaines et sociales, les sciences de la Terre, ainsi que l’aménagement, l’architecture et l’ingénierie.
Il s’agit de mettre au jour la façon dont les risques sont envisagés par les acteurs pour les prévenir et mieux les accompagner.
En savoir plus
En savoir plus
La ruse de guerre par le prisme du discours
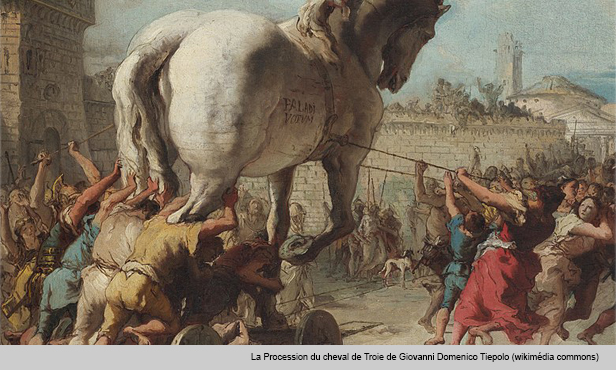 Penser et dire la ruse de guerre de l'Antiquité à la Renaissance vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté sous la direction de Michel Pretalli (1) dans le cadre de l’action de recherche « Ruse » qu’il développe à la MSHE depuis trois ans. L’ouvrage fait suite à un colloque pluridisciplinaire éponyme qui s’est tenu en 2018 consacré à la ruse militaire analysée à travers les discours.
Penser et dire la ruse de guerre de l'Antiquité à la Renaissance vient de paraître aux Presses universitaires de Franche-Comté sous la direction de Michel Pretalli (1) dans le cadre de l’action de recherche « Ruse » qu’il développe à la MSHE depuis trois ans. L’ouvrage fait suite à un colloque pluridisciplinaire éponyme qui s’est tenu en 2018 consacré à la ruse militaire analysée à travers les discours.Rencontre avec Michel Pretalli.
Vous êtes responsable d’une action de recherche dont l’objet est la ruse. Comment s’est construit votre intérêt de chercheur pour la ruse ?
De façon assez naturelle, en fait : mon objet de recherche principal est la littérature militaire du XVIe siècle et l’on y rencontre de très nombreux stratagèmes, qui sont souvent ceux hérités d’auteurs grecs ou romains, tels que Frontin ou Polyen. La Renaissance, comme on le sait, est fondée sur une réappropriation de la culture antique, mais ce qui est peut-être un peu moins connu, c’est que le phénomène n’a pas concerné que les arts et les lettres, et la guerre fait justement partie des disciplines qui furent renouvelés – en partie – sous l’influence des modèles anciens. J’ai donc commencé à m’intéresser de plus près à la ruse et, au fil de mes lectures, il m’est très vite apparu qu’elle représentait un sujet absolument captivant et bien plus vaste que je ne l’avais pensé dans un premier temps, lorsque je la considérais uniquement par la lorgnette militaire.

Compte rendu sur Les encyclopédismes en France à l'ère des révolutions (Cahiers de la MSHE) dans Francia Recensio
Lire le compte rendu
Plus d'information sur Les encyclopédismes en France à l'ère des révolutions

Un nouveau magazine de vulgarisation scientifique
 Le programme international Past Global Changes (PAGES), auquel la MSHE participe, lance un magazine de vulgarisation scientifique Past Global Changes Horizons. Destinée à un public jeune (lycéens et étudiants), cette nouvelle publication vise à apporter à ses lecteurs des connaissances scientifiques solides sur les changements environnementaux et climatiques actuels, à partir de la connaissance des changements passés. Le programme PAGES a en effet pour objet de coordonner et promouvoir des recherches sur les changements environnementaux passés pour mieux éclairer les enjeux présents.
Le programme international Past Global Changes (PAGES), auquel la MSHE participe, lance un magazine de vulgarisation scientifique Past Global Changes Horizons. Destinée à un public jeune (lycéens et étudiants), cette nouvelle publication vise à apporter à ses lecteurs des connaissances scientifiques solides sur les changements environnementaux et climatiques actuels, à partir de la connaissance des changements passés. Le programme PAGES a en effet pour objet de coordonner et promouvoir des recherches sur les changements environnementaux passés pour mieux éclairer les enjeux présents. Avec Past Global Changes Horizons, il souhaite rendre accessibles ces recherches internationales au plus grand nombre.
Past Global Changes Horizons est une publication annuelle, gratuite, disponible en ligne et au format papier à la demande.
Le premier numéro est coordonné par Boris Vannière (directeur de recherche CNRS, UBFC), Graciela Gil-Romera (post-doctorante, CSIC, Espagne) et Sarah Eggleston (responsable scientifique, PAGES).

Accueil d’un pôle ingénierie de projets à la MSHE
La Direction recherche et valorisation (DRV) de l’UFC met en place une antenne de proximité pour accompagner les chercheurs en SHS dans le montage de leurs projets de recherche. Le pôle ingénierie de projets de la DRV est accueilli à la MSHE deux fois par semaine à partir d’avril 2021. Il a vocation à informer les chercheurs sur tous les programmes de financements publics (régionaux, nationaux, européens) et à leur apporter un appui au montage de leurs projets (montage financier, conseil en rédaction, éligibilité des coûts…).
Les permanences du pôle ingénierie à la MSHE :
Salle 27, 1er étage de la MSHE
Contacts :

Compte rendu sur La petite entreprise au péril de la famille? (Cahiers de la MSHE)
La revue Travail et emploi (vol. 1, n° 161 2020) a publié un compte rendu sur l'ouvrage de Laurent Amiotte-Suchet, Yvan Droz et Fenneke Reysoo La petite entreprise au péril de la famille ? L'exemple de l'Arc jurassien franco-suisse paru en 2017 dans la collection des Cahiers de la MSHE.
Lire le compte rendu de Madlyne Samak
Plus d'information sur La petite entreprise au péril de la famille ?

Compte rendu sur Un mousquetaire du journalisme: Alexandre Dumas (Cahiers de la MSHE) dans French Studies
French Studies (vol. 74 n°3 2020) a publié un compte rendu sur Un mousquetaire du journalisme : Alexandre Dumas paru dans la collection des Cahiers de la MSHE sous la direction de Sarah Mombert et Corinne Saminadayar-Perrin
Lire le compte rendu de Edmund Birch
Plus d'information sur Un mousquetaire du journalisme : Alexandre Dumas

Compte rendu sur Les encyclopédismes en France à l'ère des révolutions (Cahiers de la MSHE)
Lire le compte rendu de Stéphanie Roza
Plus d'information sur Les encyclopédismes en France à l'ère des révolutions

Les mutations récentes du foncier et des agricultures en Europe (Cahiers de la MSHE) en accès ouvert
Accéder au texte sur le site d'OpenEdition Books

Compte rendu sur Terre et propriété à l'est de l'Europe depuis 1990 (Cahiers de la MSHE) dans Agridées
Lire le compte rendu de Hubert Bosse-PlatièreHubert Bosse-Platière
Plus d'information sur Terre et propriété à l’est de l’Europe depuis 1990

Compte rendu sur Les révolutions du commerce (Cahiers de la MSHE) dans Lecture
Lire le compte rendu de Alexandra Hondermarck
Plus d'information sur Les révolutions du commerce. France XVIIIe-XXIe siècle
Agronomie et fruitières au XIXe siècle
 Fabien Knittel, chercheur en histoire contemporaine au Centre Lucien Febvre, vient de publier Agronomie et techniques laitières. Le cas des fruitières de l'Arc jurassien (1790-1914) aux éditions Classiques Garnier. Cet ouvrage, qui s’inscrit dans l’action « Hysam » (1) développée dans le pôle 3 de la MSHE, retrace le fonctionnement original des fruitières franc-comtoises et suisses, leurs transformations durant « un long XIXe siècle » et l’émergence de l’agronomie comme discipline scientifique.
Fabien Knittel, chercheur en histoire contemporaine au Centre Lucien Febvre, vient de publier Agronomie et techniques laitières. Le cas des fruitières de l'Arc jurassien (1790-1914) aux éditions Classiques Garnier. Cet ouvrage, qui s’inscrit dans l’action « Hysam » (1) développée dans le pôle 3 de la MSHE, retrace le fonctionnement original des fruitières franc-comtoises et suisses, leurs transformations durant « un long XIXe siècle » et l’émergence de l’agronomie comme discipline scientifique.Rencontre avec Fabien Knittel
Le XIXe siècle voit se transformer les fruitières, la place et le rôle du fruitier. Comment cela se passe-t-il ?
Fabien Knittel : Concernant les fruitières franc-comtoises et suisses il est indéniable que le XIXe siècle est marqué par une réelle dynamique, à la fois technique et économique. Les fruitières sont des « associations de prêt mutuel du lait » qui permettent aux paysans associés de fabriquer du fromage pour la vente. Il faut savoir que les fruitières correspondent à une organisation originale de la production fromagère fondée sur un modèle coopératif. Ces fruitières jurassiennes suscitent l’intérêt de certains membres de l’école sociétaire – disciples de Fourier que l’on appelle souvent « socialistes utopiques », expression qu’ils réfutent d’ailleurs – comme Max Buchon ou Wladimir Gagneur. Elles intéressent aussi certains agronomes − l’agronome genevois Charles Lullin par exemple − qui y voient des manières de faire, des techniques de fabrication et des pratiques agricoles et d’élevage qui les questionnent, qu’ils décrivent minutieusement et qu’ils cherchent aussi, parfois, à améliorer.

Aglaé Navarre, premier prix en finale régionale MT 180 s
Voir la finale Bourgogne Franche Comté
Et pourtant elles étaient là
 Et pourtant elles étaient là est le titre d’un documentaire réalisé sous la houlette de Marta Alvarez (1) par un collectif d’étudiants (2) de l’UFR SLHS et de cinéastes (Carolina Astudillo Muñoz, Jairo Boisier et Lucien Petitjean). La MSHE Ledoux, qui a prêté du matériel pour filmer et enregistrer, en est partenaire (3). Et pourtant elles étaient là interroge la mémoire des groupes Medvedkine et la place des femmes dans ce cinéma militant et dans la société des années 1960-1970. Son origine est à rechercher dans des collaborations antérieures entre Marta Alvarez et Carolina Astudillo mais aussi dans un constat : « bien qu’ils soient un référent pour les cinéphiles, les groupes Medvedkine ne sont pas connus de nos étudiantes et nos étudiants » note Marta Alvarez. Pour partir sur leur trace, le collectif rencontre trois femmes qui ont participé aux groupes : Dominique Bourgon, Suzanne Zedet et Annette Paléo. A travers elles, il s’agit de « mieux connaitre l’aventure Medvedkine et les expériences des femmes de cette époque » dit la voix off sur des images d’archive.
Et pourtant elles étaient là est le titre d’un documentaire réalisé sous la houlette de Marta Alvarez (1) par un collectif d’étudiants (2) de l’UFR SLHS et de cinéastes (Carolina Astudillo Muñoz, Jairo Boisier et Lucien Petitjean). La MSHE Ledoux, qui a prêté du matériel pour filmer et enregistrer, en est partenaire (3). Et pourtant elles étaient là interroge la mémoire des groupes Medvedkine et la place des femmes dans ce cinéma militant et dans la société des années 1960-1970. Son origine est à rechercher dans des collaborations antérieures entre Marta Alvarez et Carolina Astudillo mais aussi dans un constat : « bien qu’ils soient un référent pour les cinéphiles, les groupes Medvedkine ne sont pas connus de nos étudiantes et nos étudiants » note Marta Alvarez. Pour partir sur leur trace, le collectif rencontre trois femmes qui ont participé aux groupes : Dominique Bourgon, Suzanne Zedet et Annette Paléo. A travers elles, il s’agit de « mieux connaitre l’aventure Medvedkine et les expériences des femmes de cette époque » dit la voix off sur des images d’archive.

Appel à participation à une expérience sur la perception visuelle
Pour participer : https://unifr.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_cZ0tDikvliflKv4

Compte rendu sur Terre et propriété à l'est de l'Europe depuis 1990 (Cahiers de la MSHE)
Lire le compte rendu de Jean-Paul Charvet
Plus d'information
Page 12 sur 30

